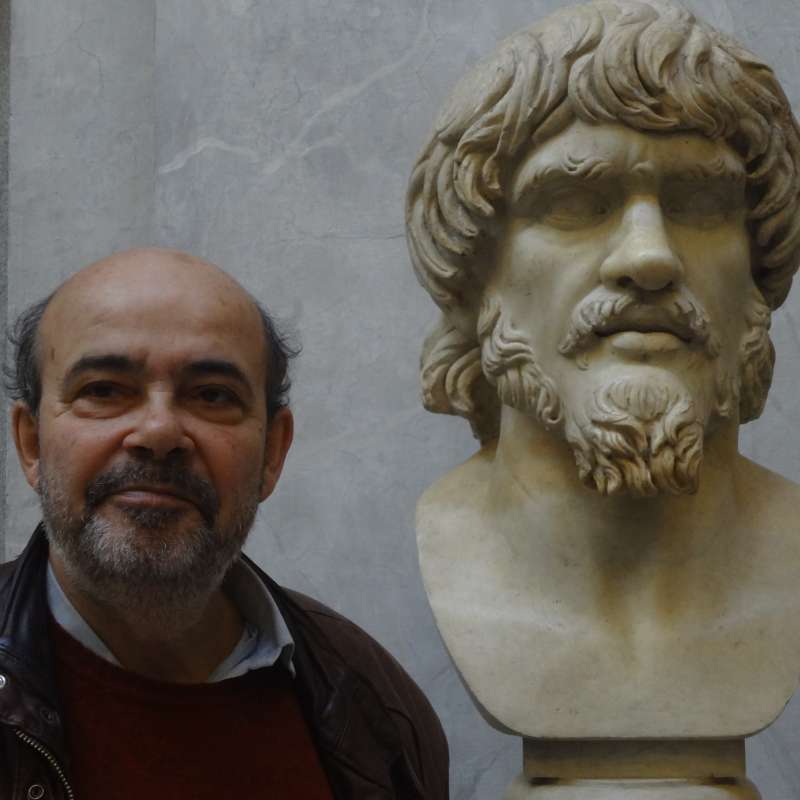Axe 3: Activisme juridique - Sur une esquisse de phénoménologie du droit social
Publié en
Cet article fait partie de « Hommage à Eliane Vogel-Polsky »
§1 Dans quelles conditions le droit social peut-il naître et croître ? Les réflexions d'il y a plus d'un siècle de Georges Sorel, sociologue et philosophe français, permettent d'éclairer les conditions d'existence du droit social et de dégager certains éléments d'une phénoménologie du droit social, à travers l'articulation de la dimension éthique du mouvement ouvrier et de la dimension juridique du socialisme. De même qu'Alexandre Kojève avait tenté une description phénoménologique de l'apparition du droit en exposant ses conditions d'engendrement dans la lutte hégélienne du maître et de l'esclave1, l'examen par Sorel de la dimension et des effets juridiques de la lutte de classe du prolétariat moderne fournit les matériaux d'une reconstruction analogue. Cet article propose tout d'abord une réflexion sur l'Europe sociale - thématique sur laquelle j'ai eu la chance de travailler avec Eliane à la fin des années 80 - avant d'examiner la pensée de Sorel. A priori, les deux sujets ne paraissent pas devoir être rapprochés, or le manque de consistance de l'Europe sociale illustre l'importance de repenser les conditions d'existence du droit social. Après avoir expliqué en quoi l'institution du droit social avait été au centre de l'émergence progressive d'un modèle social européen et de son rayonnement, nous faisons le constat de l'échec de sa transposition au niveau communautaire et de la désillusion générale frappant l'idée d'une Europe sociale. Cette situation nous a incité à approfondir la signification philosophique de sa genèse. La démarche méthodologique empruntée est herméneutique et à cette fin, des extraits de l'œuvre de Sorel et de celle du philosophe napolitain Giambattista Vico seront abondamment cités. Ce dernier a inspiré Sorel par sa conception originale et peu connue des rapports entre droit, éthique, économie et politique.
Modèle social européen et droit social
§2 De 1986 à 1989, j'ai participé à une importante recherche sur la dimension sociale du marché intérieur, sous la direction d'Eliane Vogel-Polsky et de Mario Telò, qui allait déboucher sur la publication de L'Europe sociale : illusion, alibi ou réalité ?2. Dans la Communauté Européenne à la veille du traité de Maastricht, les discussions tournaient sur la nécessité et les moyens de préserver et d'étendre au niveau communautaire le « modèle social européen ». Pour Eliane Vogel-Polsky, la notion de « modèle » ne renvoyait pas à un idéal, mais à une création historique des peuples européens, au cœur de leur tradition et de leur identité commune. La transposition au niveau communautaire de ce modèle devait impliquer la définition de normes harmonisées de droit social et d'objectifs communs de politique sociale qui en découleraient, ainsi que la mise en place des bases d'une négociation collective au niveau européen.
§3 Quelques années plus tard, dans une contribution à un ouvrage collectif publié sous la direction de Mario Telò, j'ai essayé de faire ressortir la profonde rupture qu'avait représentée la genèse de ce modèle dans l'histoire des sociétés européennes3. Je proposais de prendre la mesure de cette rupture à travers un ensemble de questions :
« Le rôle occupé par l'action autonome des acteurs sociaux ou, plus précisément, du mouvement ouvrier n'a-t-il pas eu en Europe occidentale des effets politiques sans équivalent dans l'histoire sociale des autres parties du monde ? La reconnaissance de la dimension conflictuelle des relations industrielles n'a-t-elle pas altéré en permanence les règles définissant le fonctionnement de l'organisation capitaliste de la production et du travail ? La fonction sociopolitique assumée par les organisations socioprofessionnelles n'a-t-elle pas bouleversé les principes inhérents au système de la démocratie représentative ? La naissance et le développement du droit social n'échappent-ils pas à la logique juridique dominante du droit moderne ? En particulier, le pluralisme des sources normatives en matière sociale est-il réductible à une complémentarité fonctionnelle ou renvoie-t-il à un mode inédit d'édiction et d'interprétation de la règle ? Le mode de légitimation du politique dans les sociétés contemporaines se limite-t-il au respect des valeurs et des règles de l'État de droit en général ou faut-il y inclure comme spécification sa nature d'État de droit social ? Et finalement, l'interrelation entre modèle social et État national relève-t-elle d'une solidarité consubstantielle ou peut-elle être considérée comme historiquement accidentelle »4 ?
§4 Je suggérais de centrer l'analyse sur « la nature spécifique de l'institution du droit social » autour de laquelle s'était construit le modèle social européen, avant tout par rapport à sa portée comme mode d'intégration sociale et comme mode de légitimation du politique. Avec pour résultat « une forme d'intégration sociale et politique inédite dans l'histoire, sans laquelle le capitalisme n'aurait probablement pas survécu ».
§5 En ce qui a trait au droit social comme mode d'intégration sociale, la création du droit social a non seulement enrichi le domaine matériel du droit, à travers son extension à de nouvelles zones de la vie sociale, mais elle a altéré le mode d'existence sociale du droit en tant quel tel, son mode d'élaboration et de renouvellement et jusqu'à sa définition même. Georges Gurvitch avait déjà mis en lumière à quel point l'institution du droit social bouleverse la logique juridique héritée sur trois aspects : 1) le caractère étatique du droit positif ; 2) le dogme de l'unité du droit, sous la domination de la loi ; 3) la soumission stricte du juge aux propositions du droit formulées au préalable5. Le pluralisme des sources normatives du droit social ne représentait pas seulement un état de fait empirique, mais avait traduit la reconnaissance par la société de l'activité autonome de certains groupes sociaux qui, à travers la ''matérialisation'' de nouvelles significations sociales, modifie la corrélation établie entre le système normatif institué (y compris l'ordre juridique) et les états de fait. Le modèle social européen correspond à l'ouverture d'un espace où le fait peut devenir droit et le droit peut devenir fait.
§6 En ce qui a trait au droit social comme mode de légitimation du politique, la notion d'État de droit social pourrait être conçue comme une médiation opportune entre celles d'État de droit et d'État social pour la formulation d'une théorie de la légitimation du politique dans la société contemporaine. Comme l'avait déjà depuis longtemps exposé Jürgen Habermas, en s'appuyant sur Max Weber, dans les systèmes de domination rationnelle/légale contemporains (État de droit), la conformité à la loi positive est un indice nécessaire de légitimité politique, ce n'en est pas un indice suffisant6. L'ordre social et politique n'y est légitimé que par référence à des valeurs qui lui sont supérieures et qui peuvent même conduire à remettre en question la domination qui s'y exerce. L'instauration, puis le déploiement de l'État social visaient à répondre à des revendications matérielles de la population à travers des dispositifs administratifs assurant la mise en œuvre de politiques sociales. Mais l'institution du droit social revêtait encore une autre dimension : celle de l'intégration dans le domaine du droit de considérations « substantielles » et donc toute la problématique de l'élargissement des « droits subjectifs formels » en « droits subjectifs substantiels », du passage des droits/libertés aux droits/créances, selon l'expression de Raymond Aron, de la référence à l'existence de « droits fondamentaux » d'ordre économique, social ou culturel.
§7 Pendant près d'un siècle, le domaine du droit social a été l'objet d'une croissance, d'un affermissement et d'un enrichissement continus à la fois sous l'effet d'impulsions extrajuridiques (la demande des mouvements sociaux) et du développement de ses propres présupposés. Ce processus a cependant toujours été canalisé et limité : « le politique a dû constamment veiller à ce que cette dynamique soit l'objet d'une autolimitation, notamment en limitant la reconnaissance de certains droits sociaux (avant tout les ''droits sociaux fondamentaux'') à une forme de statut métajuridique qui en neutralise la portée effective, neutralisation à laquelle la réglementation administrative de l'octroi de prestations sociales permet cependant de suppléer »7.
§8 En 1994, je soulignais en conclusion que la transposition du modèle social européen au niveau communautaire dépendait « en définitive de l'action de facteurs extrajuridiques dont l'absence ou la faiblesse restent patentes »8.
Vingt-cinq ans plus tard ces considérations hypothétiques ne sont plus de mise. Non seulement « l'Europe sociale » n'a effectivement été qu'une simple illusion mais le cours suivi par l'intégration européenne a représenté l'un des principaux facteurs, parfois direct, le plus souvent indirect, du recul et du démantèlement partiel du modèle social européen. Avec pour effet que la remise en cause de l'État de droit social a puissamment impulsé la crise de légitimité politique dans laquelle ont plongé les démocraties européennes.
Techniquement parlant, le droit social subsiste et subsistera comme un secteur particulier de l'ordre juridique des États européens et de l'Union européenne. Mais le processus historique qui l'avait porté comme une création normative et institutionnelle connaît une régression généralisée, comme en témoignent par exemple les « réformes » du droit du travail de ces derniers temps de l'Allemagne à l'Italie et de la France à la Hongrie -- une régression dont des acteurs institutionnels européens sont souvent des protagonistes actifs9.
§9 Eliane Vogel-Polsky partageait ce diagnostic négatif sur l'involution du droit social et la « constitutionnalisation ordolibérale » (Quinn Slobodian) de l'Union européenne, garantie par une Cour de Justice vouée au respect exclusif de la libre circulation. Une question récurrente de sa réflexion dans les dernières années de sa vie portait sur la détermination des conditions qui permettraient de renverser ce processus et d'ouvrir la voie à de nouvelles impulsions créatrices dans le domaine du droit social.
De Vico à Georges Sorel : droit et philosophie de l'histoire
§10 La réflexion sur le déclin du droit social devrait inciter, pour en prendre la mesure, à se replonger dans l'époque de sa naissance, il y a plus d'un siècle Je n'ai pas en vue ici une description à caractère historique, mais plutôt une réflexion d'ordre philosophique sur le sens qu'avait revêtu sa genèse.
J'ai choisi d'y procéder indirectement, à travers l'approche du droit social et de sa genèse présente dans l'œuvre de Georges Sorel. Du tohu-bohu intellectuel et politique que forment les très nombreux articles consacrés par Sorel au mouvement ouvrier et au socialisme entre 1897 et 1908, il est néanmoins possible de dégager certains fils conducteurs. Georges Sorel lui-même, en se repenchant en 1914 sur cette production, jugeait qu'il avait énoncé « durant une période d'environ dix ans des opinions peu conciliables sur les moyens qu'il conviendrait d'employer pour résoudre les questions ouvrières », qu'il doutait désormais fort que « l'agitation du monde du travail puisse être condensée, même symboliquement, sous l'ordonnance d'une synthèse propre à rendre de sérieux services » mais qu'il pensait néanmoins que « la multiplicité des opinions successivement avancées » représentait « la manifestation particulièrement frappante de la liberté dont jouit l'esprit quand il raisonne sur les choses produites par l'histoire »10. C'est de cette liberté de l'imagination théorique que je m'autorise pour dégager des écrits soréliens les éléments d'une phénoménologie du droit social qui me semblent en éclairer la genèse.
§11 L'importance déterminante accordée par Georges Sorel à la dimension juridique de tous les phénomènes sociaux (« on ne peut posséder à fond une question sociale que tout autant que l'on a examiné ses aspects juridiques »)11 a très souvent été attribuée au poids des catégories du droit dans l'héritage intellectuel de la pensée française. On y a vu plus précisément l'un des vecteurs de cette « proudhonisation » du marxisme à laquelle il est souvent assimilé et par où il s'opposait à ces marxistes qui considéraient le droit « comme un appareil imaginé par des gens retors pour cacher la réalité des choses »12 et les institutions juridiques « comme des procédés machiavéliques, employés par les classes dirigeantes en vue d'assurer le maintien de l'ordre à leur profit »13. Sans négliger ce rapport à Proudhon, sur lequel je reviendrai, le cadre philosophique dans lequel s'inscrit cette détermination est à la fois bien antérieur et beaucoup plus original intellectuellement. C'est de la métaphysique historique du philosophe napolitain Giambattista Vico (1668-1744), à laquelle il a consacré une très longue étude en 1896 dans la première revue théorique marxiste française Le devenir social14, que Sorel dérive sa conception des rapports entre droit, éthique, économie et politique et sa représentation « juridique » de la lutte des classes et de la révolution sociale. Philosophe toujours largement méconnu, Vico est le premier penseur a avoir établi les soubassements d'une conception à la fois historiciste et constructiviste du droit, à laquelle Sorel a eu largement recours dans ses essais pour donner une interprétation non rationaliste de la pensée de Marx.
§12 Le plus célèbre principe du grand œuvre de Vico, la Scienza nuova, celui du verum ipsum factum, de l'identité du vrai et du fait, n'a pas une portée simplement épistémologique (« le critérium du vrai c'est de l'avoir fait ») mais représente également une thèse métaphysique sur l'histoire et l'esprit humain : « l'humanité est son œuvre à elle-même » et donc « s'il est vrai que les sciences doivent commencer au point même où leur sujet a commencé, la métaphysique commença à l'époque où les hommes se mirent à penser humainement, et non point à celle où les philosophes se mirent à réfléchir sur les idées humaines ». Il en va ainsi de l'origine de toutes les branches de la philosophie : « c'est de la place d'Athènes que sortirent les principes de la métaphysique, de la logique et de la morale. La liberté fit la législation et de la législation sortit la philosophie »15.
§13 Sorel suggère de généraliser cette dérivation qu'il dénomme la « loi idéogénétique de Vico »16. Celle-ci s'applique entièrement à la genèse du droit et des conceptions juridiques. On ne peut ni « construire un droit par la pure raison », ni « se borner à la constatation des faits de l'histoire », mais il faut, selon les termes de l'Axiome 11 de Vico, remonter au « sens commun appliqué par les hommes aux nécessités ou utilités humaines, double source du droit naturel des gens »17. Vico insiste sur « la préexistence de la sagesse vulgaire » : « il a fallu une réalisation avant l'idéation, qui nous paraît aujourd'hui isolée de sa source »18. Georges Sorel illustre cette loi idéogénétique par le passage du Capital où Marx se demande pourquoi Aristote lorsqu'il analysait la nécessité de l'équivalence de marchandises objets d'un rapport d'échange n'était pas arrivé jusqu'au concept de valeur-travail en tant que « substance commune » de celles-ci. Marx l'expliquait par le fait que « la société grecque avait pour base naturelle l 'inégalité des hommes et de leurs forces de travail. Le secret de l 'expression de la valeur, l 'égalité et l 'équivalence de tous les travaux, parce que et en tant qu 'ils sont du travail humain, ne peut être déchiffré que lorsque l 'idée de l 'égalité humaine a déjà acquis la ténacité d 'un préjugé populaire »19. Or, affirme Sorel, « ce préjugé populaire appartient à l'ordre juridique »20 et sans sa présence, les rapports économiques resteraient indéchiffrables.
§14 Pour Sorel, une interprétation contemporaine de la philosophie de Vico (une fois retranchée toute l'« histoire idéale » à caractère providentialiste) doit reprendre l'idée que « l'histoire a une identité de substance » dans laquelle il faut comprendre « tout l'ensemble des manifestations de l'activité humaine, en tant qu'elles sont rapportées aux lois propres du développement de l'esprit. Entre toutes les choses qui se succèdent, nous trouvons ainsi un lien humain qui leur donne leur véritable unité fondamentale »21.
Sorel relève que pour Vico, ces « lois propres du développement de l'esprit » sont des « lois de suites », qui « définissent l'évolution des états par lesquels passe l'esprit d'une manière uniforme, pour aller des origines affectives et irraisonnées aux développements intelligibles et scientifiques »22. Il en va ainsi du droit, qui « passe de formes primitives, tout imprégnées d'instinct, à des formes supérieures, dirigées par l'intelligence », c'est-à-dire qui passe « de la nuit émotionnelle à la clarté des discussions juridiques »23.
§ 15 Les lois de suites suivent à travers l'histoire un mouvement de corsi et de ricorsi : « la loi des éternels recommencements s'exerce ici comme dans toutes les sphères humaines ; des contingences viennent ramener l'esprit, de temps à autre, à des formes primitives ; des sentiments servent à rajeunir l'évolution, et font naître de nouveaux processus qui, partant de l'impulsion passionnée, sont destinés à atteindre les régions de la raison - si les circonstances leur donnent le temps de le faire »24. Il ne s'agit pas d'une succession de cycles au sens propre, mais de retours aux impulsions originelles, entraînant un rajeunissement des institutions et des lois et une redynamisation du mouvement historique, « quand l'âme populaire revient à des états primitifs, que tout est instinctif, créateur et poétique dans la société »25.
L'histoire se déroule à travers une multiplicité de ces suites « ayant leur existence propre, leur autonomie, se produisant à toutes les époques, se mêlant dans la société de la manière la plus confuse. Au lieu d'un bloc homogène, nous avons un enchevêtrement d'évolutions, qui ne sont susceptibles d'aucune définition générale, parce qu'à un instant donné on les trouve à tous les moments de leur développement »26.
§16 Pour Vico, « le mouvement historique ne consiste pas dans un développement homogène [... ] il y a une grande complexité de changements réagissant les uns sur les autres », néanmoins un « fait capital domine l'histoire primitive », « la lutte des groupes »27. Le paradigme de celle-ci, auquel il revient sans cesse, est représenté par le conflit des patriciens et des plébéiens dans la Rome antique et Georges Sorel souligne la portée heuristique de ce choix : « l'histoire contemporaine nous montre dans l'ordre du droit économique, des luttes et des transactions qui rappellent, par bien des côtés, l'histoire antique de Rome : quand on propose une réforme quelconque, les classes supérieures protestent contre la tyrannie à laquelle on veut les soumettre et réclament au nom de la liberté individuelle que la loi nouvelle va restreindre » 28.
§17 Dans le déroulement de la lutte des groupes, les « lois de suites » étudiées par Vico se manifestent autrement que dans le champ des évolutions psychologiques individuelles : « dans les groupes se développent des sentiments d'un genre différent, ou plus exactement les sentiments individuels se colorent d'une autre manière ». Aux « origines affectives et irraisonnées » des mouvements sociaux sont à l'œuvre des « tons affectifs de groupe » qui s'expriment à travers des revendications, mais qu'il ne faut pas confondre avec des « idéalités juridiques ». Ainsi par exemple, la passion de l'égalité en tant que « moteur révolutionnaire » est complètement distincte d'une « théorie métaphysique des droits égaux »29.
Sorel reprend à Vico l'idée que « l'étude des transformations des sentiments » représente le premier niveau de la compréhension du mouvement historique : « elles marquent, avec une délicatesse parfois infinie, les états par lesquels passe un peuple [ou un groupe social ] ; elles fournissent d'excellentes explications pour les mouvements, les résolutions des individus, mais elles doivent être rapprochées des conditions générales d'existence »30.
§18 Sorel souligne en particulier le rôle de la cristallisation de trois éléments sentimentaux en une « élaboration morale qui alimente la lutte des classes » : (1) « le désir d'assurer un respect plus grand de la dignité humaine » ; (2) « la protestation de l'opprimé invoquant son titre d'homme contre les supériorités historiques » ; (3) « le sentiment du progrès éthique » c'est-à-dire l'espérance d'une vie plus heureuse et plus éclairée pour les générations à venir. Sorel ajoute que ces éléments « ne dérivent point de la nature humaine mais de certaines conditions historiques » 31.
Les sentiments éthiques représentent en ce sens la première strate et le point de départ des luttes sociales, avant toute expression intellectuelle et a fortiori avant toute élaboration théorique : « les appréciations morales jouent un rôle capital dans la lutte des ordres antiques et dans la lutte des classes modernes. Mais c'est parce que ces appréciations ne sont pas scientifiques et démontrables qu'elles jouent ce rôle : la lutte ne saurait s'engager sur un théorème de mécanique. Les jugements moraux sont donc, à un certain point de vue, la base de tout le mouvement historique »32.
Lutte des classes et lutte sur le droit
§19 Pour Vico, la lutte des classes implique d'emblée le domaine du droit : « à l'origine le droit constitue une sorte de propriété des familles patriciennes ; c'est à cette propriété que s'attaque la plèbe, qui demande à jouir de droits que l'ancien régime réserve aux seuls nobles : ceux-ci veulent rester maîtres et posséder un pouvoir libre »33. Au contraire, la lutte des groupes subalternes peut avoir pour contenu, comme dans le cas des plébéiens romains, d'être une « lutte pour acquérir des droits »34. En d'autres termes, « la cause fondamentale du mouvement », c'est « la lutte des classes pour la conquête de droits »35.
§20 Sorel procède à une généralisation de la thèse de Vico. Il propose de définir la lutte de classes comme une « lutte sur le droit »36.
La « lutte sur le droit » doit être conçue comme un des deux types fondamentaux de lutte politique et donc aussi de révolution : « la lutte peut avoir pour objet l'exploitation de la force publique, ou bien elle peut avoir pour objet un changement dans la situation des classes. Vico savait parfaitement distinguer les deux cas : le premier lui semble appartenir à la décadence des États populaires ; le second seul était fécond. Les luttes du pauvre et du riche dans les républiques grecques représentent bien le premier type ; celle des plébéiens contre les patriciens le second »37. La thèse de Marx dans Misère de la philosophie est que « la lutte de classe à classe est une lutte politique (...), lutte qui portée à sa plus haute expression est une révolution totale »38. Cette lutte, explique Sorel, doit être interprétée en fonction des « divers sens du mot politique » : soit, la lutte politique ne correspond qu'à « un simple conflit d'intérêts »39 et s'exprime à travers l' « agitation des partis qui cherchent à conquérir l'Etat pour le plus grand profit de leurs membres », soit elle a pour contenu des « mesures d'ordre général ayant pour objet de modifier, d'une manière notable, le système juridique existant »40. Une dichotomie du même type s'applique à l'appréciation des révolutions : « il y a eu dans toutes les révolutions deux éléments : une conquête du pouvoir, qui donne des avantages à une minorité, et une conquête de droits »41. Pour Sorel, cette dernière conception de la révolution est la seule qui corresponde vraiment à la pensée de Marx : « quoi qu'on en ait dit, la lutte des classes, telle que Marx la conçoit, est une lutte sur le droit » et il s'adjuge le mérite d'avoir été l'un des premiers à souligner la nécessité de « compléter les formules employées habituellement par les marxistes en indiquant le but juridique de la lutte »42. Une « lutte de classe » menée uniquement autour des enjeux de la conquête du pouvoir exprime une « religion de la magie politique », dans laquelle des ouvriers, « écrasés par la fatalité économique », sont aliénés à un « respect superstitieux dans le pouvoir mystérieux de la force politique »43. En revanche, la prépondérance de la dimension juridique de la lutte est l'expression d'une « conscience de classe », de l'existence de ce que Marx en termes hégéliens dénommait une classe pour-soi, une « classe pour elle-même »44. Affirmer que la lutte de classe est une lutte sur le droit implique, d'après Sorel, d'articuler la lutte politique, conçue comme un moyen, à la réalisation du but juridique :
« Chaque classe élabore son système juridique, ayant une relation très intime avec ses conditions d'existence, fondé sur son mode d'appropriation, et émet la prétention d'imposer son système comme le droit positif de la Cité. A cette prétention d'une classe s'oppose la prétention d'une autre ; et la lutte sociale s'engage pour faire décider par la force quel système l'emportera (...) Une prétention juridique n'aurait aucun sens si ceux qui l'élèvent ne cherchaient à mettre de leur côté la force qui décide ; c'est ce que tout le monde appelle engager une lutte politique. Il ne faut jamais oublier quelle est la substance du conflit ; il est engagé pour faire triompher certaines règles juridiques revendiquées par la classe qui combat l'ordre existant : la conquête du pouvoir, ou plutôt l'action sur le pouvoir (qui constitue l'action dite politique), est le moyen qui est subordonné au but juridique » 45.
§21 La mise en œuvre d'un nouveau système juridique peut procéder par des transactions ou par une révolution. Le procédé transactionnel suppose l'existence d'une « région douteuse du droit, une situation précaire justifiée par les habitudes anciennes, mais destinées à disparaître le jour où des circonstances nouvelles en montreraient les inconvénients. C'est dans cette région que s'opère la réforme ». Elle peut prendre un caractère limité « de manière à ne pas dépasser ce qu'on peut appeler le seuil de l'accord possible », avec pour sentiment dominant (très souvent répandu chez les juristes !) la préoccupation d'un passage progressif, « l'état nouveau étant amené par la discussion, la comparaison, et manifestant la réaction désirable de la pensée réfléchie sur la matière historique ». Auquel cas, la réforme s'impose souvent même aux conservateurs, « les évolutions psychologiques de ce genre sont irréversibles, comme Vico l'avait reconnu ; pour peu que nous ayons le sentiment qu'une transformation juridique s'est faite dans l'ordre naturel de la psychologie, nous n'avons pas le sentiment de la révolte et l'esprit du retour en arrière. La réforme devient intangible, parce qu'elle nous apparaît avec ce ton de sentiment particulier qui correspond à la notion vulgaire du progrès »46.
Cependant, au cas où l'action politique amène un bouleversement des rapports de force, la transaction débouchera sur une transformation plus radicale : « le pouvoir politique, dans lequel se concentre et s'organise la force, proclame un système mixte, sur l'application duquel s'élèvent rapidement de nouveaux conflits »47.
Mais « l'histoire ne montre pas toujours des transformations faites par ce procédé transactionnel »48. L'histoire des révolutions en est la démonstration : « bien des fois on a essayé de franchir les limites de la région douteuse du droit, pour établir un nouveau régime par la force... Les guerres civiles sont si féroces parce qu'elles ont justement pour objet la transformation des institutions par la violence et par la destruction des adversaires »49.
§22 Sorel cherche à appliquer cet enseignement de Vico aux combats et aux objectifs du mouvement ouvrier moderne, à travers une vision dialectique originale du rapport entre transactions et révolution. Tant que le mouvement ouvrier ne rassemble qu'une minorité, et à moins de concevoir la conquête du pouvoir politique à la façon blanquiste, comme l'établissement d'« un long régime terroriste imité de 1793 »50, des compromis sont inévitables : « la transaction est le caractère nécessaire d'une lutte entre deux minorités actives se battant pour le partage ; elle assure la continuité en agrégeant les nouveaux venus à la civilisation des anciens possesseurs du droit »51.
§23 Cependant, si trois conditions sont remplies, une révolution prolétarienne doit être envisagée : (1) « le développement de la conscience de son rôle historique dans le prolétariat » ; (2) une adaptation suffisante de « l'organisation du travail par la grande industrie aux besoins et aux conditions de la production collective » ; (3) « il faut que les hiérarchies sociales ne soient plus que des ombres »52. La deuxième de ces conditions explique pourquoi Sorel a toujours estimé que le socialisme et le syndicalisme devaient appuyer le progrès technique et les courants les plus modernisateurs du capitalisme industriel, mais je n'envisagerai pas cette question ici. La première et la troisième condition font entièrement dépendre la possibilité d'une révolution de la maturation interne du prolétariat, c'est-à-dire de ses qualifications techniques, de son niveau culturel, de sa préparation autogestionnaire, mais aussi du développement de sa « capacité juridique » : « si le prolétariat arrive à être, dans l'industrie, la seule organisation vivante ; s'il ne reste à côté de lui qu'une infime minorité impuissante et nuisible ; s'il ne renferme dans son sein aucune forme hiérarchique, susceptible de se séparer de sa masse pour former une faction gouvernante ; si enfin le développement de la législation sociale l'a pénétré de droit : la continuité économique et juridique sera assurée sans transaction »53.
§24 Dans cette perspective, une révolution prolétarienne pourrait représenter à la fois une solution de continuité politique sans équivoque, avec un déplacement marqué de l'hégémonie de classe dans l'État, et un processus de continuité juridique ininterrompue, « si la civilisation actuelle a élaboré un système de lois réglant d'une manière prudente les rapports des coopérateurs industriels : la partie capitaliste des Codes pourra disparaître, comme a disparu le régime féodal ... Il est donc d'une très haute importance pour les socialistes d'accélérer le mouvement des réformes juridiques »54.
§25 C'est en fonction de ces critères que Georges Sorel apportera son soutien à Edouard Bernstein en 1898-1900, pendant la querelle du révisionnisme au sein du parti social-démocrate allemand. Sorel n'y voit pas tant une opposition du réformisme à la révolution, ce qui lui paraît une représentation d'ordre complètement idéologique et abstraite, qu'une tentative de rejeter la constitution sous le couvert de l'orthodoxie marxiste « d'une oligarchie de maîtres intellectuels, qui ont pour métier de gouverner le monde ouvrier »55. Un parti social-démocrate comme le SPD est avant tout une machine électorale qui repose sur « une abdication des gens qui connaissent leur propre incompétence et leur propre incapacité à agir : ils déclarent qu'ils donnent carte blanche à un candidat qui s'annonce comme un grand magicien et ils lui promettent de le laisser faire à sa tête »56. Selon Sorel, le « but final » réel de la social-démocratie, le socialisme d'État, repose sur la même prémisse : « puisque les ouvriers ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes et qu'on veut cependant les soustraire à la direction des capitalistes, il faut bien recourir soit à l'État, soit à la Commune pour diriger l'industrie »57.
§26 Ce que Sorel juge important dans la bernsteiniade n'est pas le réformisme, mais ce qui lui semble exprimer une stratégie d'auto-émancipation prolétarienne :
« La politique réformiste, à laquelle se rallie M. Bernstein, ne doit pas être jugée par l'importance matérielle des réformes, mais par les conséquences morales que celles-ci peuvent avoir pour l'avenir ... On arrive ainsi à comprendre que les questions sociales ne se résoudront point par la science de quelques docteurs et par l'habile tactique de quelques chefs, mais qu'elles se résolvent tous les jours, au fur et à mesure que s'accroît la moralité des travailleurs. Les anciennes formules autoritaires du socialisme d'Etat se tempèrent, parce que le sentiment du self government se développe dans les masses »58.
En définitive, l'opposition classique au sein du socialisme entre progression et révolution « est tout à fait insuffisante pour caractériser la différence à étudier. Il ne s 'agit pas de savoir si on passera brusquement ou lentement d 'un régime à un autre ; c 'est là une question assez secondaire. Le problème social, conçu au sens marxiste, est de savoir si la classe gouvernée se forme intellectuellement et moralement, de manière à pouvoir se passer de la tutelle qui lui a été jusqu'ici imposée. Le vrai marxiste considère toutes les questions contemporaines dans leurs rapports avec le développement de la conscience dans le prolétariat» 59.
§27 Pour conclure, le jugement politique porté par Georges Sorel sur les luttes sociales, sur l'action du mouvement ouvrier et sur les différents courants du socialisme est donc toujours fondé sur des critères éthiques. Mais ceux-ci débordent le champ de la morale proprement dite et débouchent sur l'exigence d'une création juridique autonome.
Le mouvement ouvrier entre morale et droit
§28 La corrélation entre la dimension éthique du mouvement ouvrier et la dimension juridique du socialisme traverse diverses configurations que nous allons, à présent, examiner. Sorel y décèle une dialectique à l'œuvre et c'est par le jeu de celle-ci que s'esquisse une genèse phénoménologique du droit social.
1. « Le moteur de tout le mouvement socialiste est l'opposition qui se produit entre la morale et le droit ».60 Le sentiment moral oppose le « titre humain » au « titre historique » sur lequel repose l'organisation sociale établie : « les plaintes de l'individu opprimé nous semblent plus sacrées que les traditions, les nécessités de l'ordre et les principes sur lesquels repose la société ». Le système juridique antérieur est ébranlé et « considéré comme indigne de l'homme », mais en elle-même « la morale ne nous fournit aucun moyen pour construire un système juridique nouveau ; elle n'apporte que des négations »61. C'est cette dimension exclusivement négative jouée par la morale qui rend compte du rôle de la violence dans l'histoire : « on trouve la violence immédiate à l'origine de l'histoire du droit ; on la retrouve tout le long de l'histoire ; mais son rôle est plus ou moins considérable et ses effets plus ou moins redoutables. Au fur et à mesure que l'on avance, elle perd ses caractères de contingence aveugle et irrésistible ; elle devient, en même temps, moins sanglante » 62.
2. Pour Sorel, la corrélation entre l'éthique et le droit varie suivant les phases parcourues par « l'évolution de la révolution » : « tout d'abord il ne s'agit que de renverser ; peu à peu on se propose de créer ou de donner à des créations ébauchées une extension qu'elles ne pourraient prendre si on ne triomphait de la compression exercée par l'État traditionnel »63.
a . Une première phase a lieu lorsqu'une révolte populaire ou une révolution ne sont guidées que par les sentiments moraux et par une « conception passionnée du droit naturel »64. Elles seront dominées par des affects de haine et par la violence pure : « quand on dit aux pauvres que les détenteurs de la puissance (soit politique, soit économique) sont des voleurs, qui, depuis des siècles, usurpent ce qui ne leur appartient pas ; quand on leur crie de se lever pour reprendre ce qui leur est dû ; quand on leur dépeint l'existence des classes supérieures comme le seul obstacle qui empêche le bonheur du peuple ; - les pauvres en arrivent bientôt à croire que les dernières violences sont permises contre les ennemis de l'humanité »65.
b . Une seconde phase est celle de la « révolution légalitaire », « lorsque les novateurs ne mettent plus leurs principales espérances dans les actes de violence, mais arrivent à croire qu'ils peuvent utiliser les forces de l'État existant et les employer dans un but tout autre que celui en vue duquel la société actuelle les a organisées »66. A ce stade, « l'on conserve la forme juridique ancienne, sans avoir encore construit un contenu éthique capable de s'affirmer avec indépendance »67. Il s'agit d'un moment transitoire, mais nécessaire : « il faut passer par ce formalisme pour arriver à un nouveau droit »68.
c . La troisième phase représente le « moment de l'éthique vivante ». Elle correspond à la pleine maturité du mouvement ouvrier, « quand l'esprit éthique pénètre complètement la révolution » : « la violence reste toujours ; mais elle n'est plus que l'effort nécessaire pour faire tomber de vieilles branches, pour donner de l'air à des créations jeunes et pleines de vie, pour assurer la victoire à des institutions ayant fait leurs preuves »69.
A travers l'histoire du mouvement ouvrier, cette évolution se répète à maintes reprises et c'est pourquoi il est essentiel de bien distinguer « les thèses juridiques, que le socialisme dans son âge mûr doit formuler, d'avec les hypothèses éthiques, que le socialisme met en avant pour combattre l'ordre social et pour diriger l'esprit vers les réformes »70.
§29 En tant que philosophie du droit, le socialisme ne répond pas à un paradigme unitaire : « il est impossible de ramener à un principe unique aucun grand mouvement social... Partout l'on trouve un mélange de deux principes contraires ; ils correspondent à deux systèmes de tendances et de sentiments qui se mêlent, se heurtent et se combinent »71. Le socialisme procède de deux conceptions éthico-juridiques opposées que Sorel dénomme « droit naturel » et « droit historique ».
§30 La première est bien évidemment le droit naturel des Modernes, tel qu'il est issu des traditions de la bourgeoisie libérale et de la Révolution française. Puissant instrument de critique de l'ordre social et de lutte contre les pouvoirs établis, « il ne fournit que des résultats négatifs et son action est purement destructive »72. Les droits de l'Homme sont parfois décrits comme trouvant leur origine dans des théories du droit naturel et critiqués pour cette raison.73 En raison de leur abstraction, les droits de l'Homme ne sont pas la base à partir de laquelle puisse s'édifier un droit social ; ils sont trop intrinsèquement liés à une figure social-historique précise. En effet, contrairement à la longue lignée d'auteurs, depuis Burke jusque Hannah Arendt, qui reprochaient à l'homme des droits de l'homme son abstraction indéterminée, Sorel tient cette abstraction pour trop concrète, il considère l'homme des droits de l'homme comme l'expression abstractisée d'un type historico-social bien spécifique :
« L'homme sur lequel raisonne cette philosophie est un propriétaire foncier abstrait : le citoyen néo-romain est tellement grand que les conditions matérielles de la production et de l'échange sont fort négligeables devant les puissances intérieures qui découlent de sa vertu ; les déterminations juridico-économiques sont supprimées et il ne reste qu'une abstraction conforme aux aspirations de gens nourris de la lecture de Rousseau. L'homme de la nature est un Romain transporté au dix-huitième siècle, vivant heureux sur son petit domaine, toujours prêt à défendre ses droits et prenant les armes au premier appel pour voler à la défense de sa patrie. C'est pour ce paysan, fabriqué à l'imitation de l'antique, que la Déclaration des droits de l'homme a été rédigée »74.
Si le socialisme se revendique de l'héritage du droit naturel, c'est par mimétisme intellectuel et affectif : « la langue politique a été faite par les théoriciens du droit naturel » et « dans une société pénétrée d'esprit hiérarchique, très nombreux sont les hommes qui veulent imiter les classes supérieures ». Il faut s'écarter de cet héritage : le prolétariat n'est pas un « quatrième État » et le bouleversement qu'il vise ne doit pas se modeler sur « le type de la transformation qui a donné le pouvoir au Tiers État » 75.
§31 La seconde conception éthico-juridique à la base du socialisme, le « droit historique », est résolument contemporaine et authentiquement ouvrière :
« C'est à la fois une révolte et une organisation ; c'est l'œuvre propre du prolétariat créé par la grande industrie ; ce prolétariat s'insurge contre la hiérarchie et la propriété ; il organise des groupements en vue de l'aide mutuelle, de la résistance en commun, de la coopération des travailleurs ; il prétend imposer à la société de l'avenir les principes qu'il élabore dans son sein pour sa vie sociale propre ; il espère faire entrer la raison dans l'ordre social en supprimant la direction de la société par les capitalistes »76.
Nous présenterons ici deux exemples d'interprétation par Sorel de cette mise en œuvre du « droit historique » prolétarien : la limitation légale du temps de travail telle qu'elle est analysée par Marx dans Le Capital et la problématique juridique des grèves.
Marx et la limitation légale du temps de travail
§32 Les critères de la formation intellectuelle et morale du prolétariat et du développement de sa capacité juridique sont selon Sorel au centre de la problématique de Marx. Le schématisme habituel des marxistes vulgaires, séparant une base économique et une superstructure juridique qui en dériverait, est complètement étranger à la pensée de l'auteur du Capital : « Marx définit avec précision, à chaque moment du processus de la production, les règles juridiques qui s'y appliquent ; il considère le système juridique comme ossature sur laquelle s'étend le mouvement économique (...) Ce que fait Marx est une recherche métaphysique ; il chevauche, en quelque sorte, sur le droit et l'économie, pour déterminer l'allure générale et les principes essentiels de la société capitaliste »77.
§33 Dans un article publié uniquement en italien, « Le idee giuridiche nel marxismo » dans la Rivista di Storia e di Filosofia del diritto (août 1899)78, Sorel reconstruit cette unité dialectique du droit et de l'économie telle qu'elle se présente dans Le capital. Dans le contrat de travail passé entre le salarié et le capitaliste, « tous deux sont des personnes juridiquement égales »79. Le contrat de travail repose sur une symétrie absolue qui ne présente « d'autre différence d'avec tout autre genre de contrat que celle contenue dans les formules juridiquement équivalentes : Do ut des, do ut facias, facio ut des et facio ut facias » [Je donne pour que tu donnes, je donne pour que tu fasses, je fais pour que tu donnes, je fais pour que tu fasses ]80. La propriété exclusive du capitaliste sur le produit du travail du salarié est un effet direct du contrat de travail : « En achetant la force de travail, le capitaliste a incorporé le travail comme ferment de vie aux éléments passifs du produit, dont il était aussi nanti. Le procès de travail est une opération entre choses qu 'il a achetées, qui lui appartiennent. Le produit de cette opération lui appartient donc au même titre que le produit de la fermentation dans son cellier »81. Pendant la durée du procès de production, le travail du salarié « n'appartient pas plus au vendeur que n'appartient à l'épicier la valeur d'usage de l'huile vendue » et la plus-value qui en résulte pour le capitaliste représente « une chance particulièrement heureuse pour l'acheteur, mais qui ne lèse en rien le droit du vendeur [... ] La loi des échanges a été rigoureusement observée, équivalent contre équivalent [... ] et tout est ainsi pour le mieux dans le meilleur des mondes possible »82.
§34 Cependant, l'extension de la révolution industrielle et la généralisation des machines entraînent plusieurs conséquences. Le capitaliste, en tant que propriétaire des machines dont les travailleurs ne sont que de simples auxiliaires, reçoit « de par Dieu et de par le Droit une hypothèque de 24 heures pleines par jour sur le temps de travail d'un certain nombre de bras »83. Dès que la production capitaliste a atteint un certain degré, « le travailleur isolé, le travailleur, en tant que vendeur ''libre'' de sa force de travail, succombe sans résistance possible »84. Par ailleurs, elles suscitent simultanément l'introduction massive du travail des femmes et des enfants, avec comme corollaire une profonde transformation du rapport juridique : « l 'emploi capitaliste du machinisme altère foncièrement le contrat, dont la première condition était que capitaliste et ouvrier devaient se présenter en face l 'un de l 'autre comme personnes libres, marchands tous deux, l 'un possesseur d 'argent ou de moyens de production, l 'autre possesseur de force de travail. Tout cela est renversé dès que le capital achète des mineurs. Jadis, l 'ouvrier vendait sa propre force de travail dont il pouvait librement disposer, maintenant il vend femme et enfants ; il devient marchand d 'esclaves »85. Marx en tire une conclusion générale : « le machinisme bouleversa tellement le rapport juridique entre l 'acheteur et le vendeur de la force de travail, que la transaction entière perdit même l 'apparence d 'un contrat entre personnes libres »86.
§35 En réaction à cette altération du rapport, la collectivité des travailleurs va riposter : « pour se défendre, il faut que les ouvriers, par un grand effort collectif, par une pression de classe, dressent une barrière infranchissable, un obstacle social qui leur interdise de se vendre au capital par ''contrat libre'', eux et leur progéniture, jusqu 'à l 'esclavage et la mort »87. A partir de 1833 en Grande Bretagne, les premières législations sociales imposèrent la limitation de la journée de travail, d'abord pour les enfants et les adolescents, jusqu'à l'adoption en 1848 du fameux Bill des 10 heures. Pour le Dr. Andrew Ure, auteur d'une Philosophie des manufactures, la classe ouvrière anglaise portait la « honte ineffaçable d'avoir inscrit sur ses drapeaux l'''esclavage des lois de fabrique'', tandis que le capital combattait virilement pour la ''liberté pleine et entière du travail'' »88. Ce qui se joue avec la naissance de cette législation, commente Sorel, n'est rien moins qu'« un nouveau système juridique qui vient au monde en opposition au système des droits de l'homme et du citoyen : aux droits absolus, qui en réalité laissaient le pauvre sans droits effectifs, se substituent des droits spécifiques des travailleurs, une grande charte qui indique clairement quand finit le temps que vend le travailleur et quand commence le temps qui lui appartient »89.
§36 L'ouvrier comme le capitaliste sont d'accord sur une prémisse : la force de travail est une marchandise et le corps du travailleur est la machine qui produit cette marchandise. Le point de vue capitaliste ne s'intéresse pas au processus par lequel cette marchandise est produite mais uniquement à son utilisation la plus rentable possible. Le point de vue du travailleur au contraire a pour premier souci la préservation et l'entretien de son corps. Pour faire ressortir cette différence, Marx paraphrase les arguments donnés en réponse aux employeurs dans un manifeste publié par leur comité de grève, pendant la grande agitation pour la réduction de la journée de travail à 9 heures des ouvriers du bâtiment à Londres en 1860-61 : « je veux n'en dépenser [de ma force de travail ] que juste ce qui sera compatible avec sa durée normale et son développement régulier... Ce que tu gagnes en travail, je le perds en substance. Or l'emploi de ma force et sa spoliation sont deux choses entièrement différentes... Tu payes une force de travail d'un jour quand tu en uses une de trois. Tu violes notre contrat et la loi des échanges... J'exige la journée de travail normale, parce que je veux la valeur de ma marchandise, comme tout autre vendeur »90. Après avoir exposé les raisons que donnaient patrons et ouvriers pour combattre et défendre le principe des journées normales, Marx ajoute : « il y a donc ici une antinomie, droit contre droit, tous deux portant le sceau de la loi qui règle l'échange des marchandises. Entre deux droits égaux qui décide ? La force »91.
Après avoir été « arrachée lambeaux par lambeaux par une guerre civile d'un demi-siècle », que Marx décrit en détail dans le chapitre X du Capital, la législation sur la limitation de la journée de travail se généralisa, avec l'appui résigné des « magnats de l'industrie » et des « pharisiens de l'économie politique », désormais « soumis à ce qu'ils ne pouvaient empêcher ». Certes, juge Sorel, « les rapports sociaux restent formellement ce qu'ils étaient : le contrat a toujours pour objet la marchandise force de travail ; celle-ci continue à produire une plus-value ; mais l'application n'en est plus abandonnée à l'arbitraire du capitaliste. Une transaction s'est produite »92.
§37 Les deux classes qui s'affrontent, commente Sorel en paraphrasant l'Adresse inaugurale de Marx, ne le font pas seulement au nom de leurs intérêts. Toutes deux « ébauchent des systèmes juridiques pour défendre leurs prétentions »93. Ces systèmes, à leur tour, reposent sur des principes différents : « pour les patrons, la prospérité du pays est liée au jeu aveugle de la loi de l'offre et de la demande ; tout ce qui serait tenté contre cette loi naturelle troublerait l'ordre, serait contraire à la science et constituerait un abus de la police. Pour les ouvriers, la production doit être contrôlée par la prévoyance sociale ; le surmenage détruit la substance de la classe ouvrière et constitue un abus que la police doit réprimer, afin de sauvegarder l'avenir du pays »94. Marx avait d'ailleurs généralisé la portée de cette opposition : « Le bill des dix heures ne fut donc pas seulement un important succès pratique ; ce fut aussi le triomphe d 'un principe ; pour la première fois, l 'économie politique de la bourgeoisie succombait au grand jour devant l 'économie politique de la classe ouvrière »95.
§38 Pour Sorel, la lutte des classes porte donc sur des systèmes juridiques reposant sur des principes différents et « chacun des systèmes est caractérisé par l'idée politique que chaque classe se fait du rôle de la loi et par l'allure générale qui résulte de cette idée pour l'économie du pays »96. Cette lutte a été menée par les travailleurs pour la protection de leur force, de leur santé et de leur vie, mais la législation sociale sur laquelle elle a débouché la transforme en une question qui intéresse toute la société. Ce passage de l'intérêt de classe à l'intérêt public change la forme tout en conservant le contenu des exigences prolétariennes et par là il « rend le prolétariat générateur des idées politiques opérantes pour l'avenir de la société. Le prolétariat débute ainsi sa mission historique, qui est d'incarner toutes les revendications d'intérêt général »97.
« Socialisme juridique » ou philosophie prolétarienne du droit
§39 Pour en revenir aux distinctions reprises par Sorel à Vico, l'histoire de la législation sur la limitation du temps de travail relevait d'une série de « transactions » finissant par déboucher sur un système juridique mixte. En généralisant cette démarche, on pouvait établir le projet d'étayer entièrement le socialisme sur le développement du droit existant. Sorel caractérisait ainsi les traits essentiels de ce « socialisme juridique » :
(1 ) confiance absolue dans le droit, ses formules, ses constructions ; (2) constructions socialistes qui prennent pour point de départ le droit établi ; (3) répudiation de l'idée qu'il y ait un abîme infranchissable entre deux mondes ; (4) recherche de points d'attache pour établir un pont juridique entre la société actuelle et la société socialiste; (5) abandon de l'attente d'un saut brusque dans l'avenir ; (6) conservation d'un idéal collectiviste qui ne gêne pas les essais pratiques.98
Une telle démarche présuppose une évolution progressive du système juridique existant en fonction d'une conscience juridique de plus en plus partagée par tous les membres de la société. Il s'agit d'une vision progressiste typique des Lumières :
« Lorsque les idées sur le droit naturel étaient le plus répandues, on regardait le droit comme un moyen de faire disparaître les conflits sociaux : ceux-ci étaient nés de l'existence de notions contradictoires que se formaient les classes en matière juridique ; mais la science devait faire apparaître, à la place de ces notions accidentelles, les thèses vraies du droit naturel ; et quand les lumières seraient suffisamment répandues, il n'y aurait plus qu'un seul système juridique ; le peuple ne serait plus divisé en deux nations ennemies, accolées dans la Cité »99.
§40 A l'opposé de cette vue, Sorel souligne que le droit a une « fonction de division », et que celle-ci est d'autant plus marquée si l'on envisage les rapports humains en termes de classes :
« Au cours de l'histoire, les civilisations successives se distinguent surtout par leurs systèmes juridiques ; deux classes contemporaines peuvent avoir deux droits distincts et alors elles forment ce qu'on nomme deux ordres ; dans le monde bourgeois moderne, il n'y a qu'un seul droit formulé en codes, cependant il peut arriver que la classe ouvrière ait des manières de comprendre les choses qui soient inconciliables juridiquement avec les codes officiels ; et alors il y a encore lutte de classes, comme s'il y avait deux ordres ayant chacun sa loi »100.
Pour Sorel, la tâche du socialisme, en tant que philosophie du droit, est précisément de favoriser la constitution d'un système juridique prolétarien.
« Pour que le prolétariat acquière l'idée de sa mission révolutionnaire, il faut qu'il ait l'ambition de se créer un système juridique. Il ne s'agit pas ici de déclamations en l'honneur de la justice de la cause populaire ; j'entends, comme Proudhon, que les instincts, les désirs d'amélioration matérielle, les espérances d'un avenir idéal des travailleurs, doivent se traduire en doctrines pleines de réminiscences de droit romain ; la comparaison de ce système juridique du prolétariat et du système bourgeois donnerait une idée parfaitement claire de la révolution »101.
Les grèves à la lumière du droit romain
§41 C'est autour des grèves et de l'ensemble des questions juridiques qu'elles soulèvent que l'opposition des deux systèmes juridiques est la plus profonde, en faisant ressortir les principes respectifs sur lesquels ils sont fondés. C'est par l'analyse juridique des grèves que Sorel a cherché à illustrer cette thèse essentielle.
En France, les grèves avaient été assimilées au délit de coalition dans les articles 414, 415 et 416 du Code pénal de 1810 et réprimées en conséquence. Une première réforme, la loi du 27 novembre 1849, sans rien changer au caractère délictueux des faits de coalition, avait fait disparaître la différence établie initialement entre patrons et ouvriers. En 1864, le gouvernement impérial présenta une deuxième réforme qui supprimait le délit de coalition. Il confia, par habileté tactique, la présentation de la loi du 25 mai 1864 à un député de l'opposition libérale, Emile Ollivier, qui justifia cette abrogation en arguant que la pénalisation des coalitions ouvrières constituait un empiétement de la juridiction correctionnelle sur les contestations de droit privé. E. Ollivier affirmait que tout un atelier avait aussi bien le droit d'abandonner le travail qu'un ouvrier isolé :
« Qu'est-ce en effet qu'une coalition ? L'accord intervenu entre plusieurs patrons ou ouvriers d'exercer simultanément le pouvoir qui appartient à chacun d'eux en particulier, de débattre le salaire, de refuser ou d'offrir le travail. Si un ouvrier peut, sans s'exposer à aucune répression débattre les conditions de son travail, l'accorder ou le refuser, pourquoi plusieurs ouvriers réunis ne pourraient-ils pas faire de même ? Comment concevoir que le même acte innocent quand il est accompli par un seul devienne coupable dès qu'il l'a été par plusieurs »102?
§42 Sorel se réfère à Proudhon, qui traitait longuement de la question des coalitions ouvrières dans le dernier chapitre de son livre posthume De la capacité politique des classes ouvrières (1864). Dans un des paradoxes dont il est coutumier, Proudhon s'opposait à la suppression du délit de coalition mais mettait le doigt sur la faiblesse de l'argument de son défenseur : « Vous demandez en quoi la coalition diffère logiquement et juridiquement de l'unité ? C'est que la coalition est une collectivité, et qu'à ce titre elle est destructive de la concurrence, tandis que l'action d'un seul est impuissante »103.
Selon la vue libérale, « les grèves seraient des aspects particuliers du phénomène de la concurrence des producteurs. Des ouvriers cessent de travailler dans un atelier dont les conditions ne leur conviennent pas, exactement comme des capitalistes vendent à la Bourse les titres d'une affaire industrielle dont l'avenir leur inspire des inquiétudes »104. Les ouvriers, ne pouvant s'entendre avec le patron, « abandonnent les ateliers et vont chercher des entrepreneurs qui leur accordent des conditions plus avantageuses »105. Mais en pratique, ce n'est pas cela une grève ; les ouvriers « ne mettent pas plusieurs patrons en concurrence ; ils prétendent rester dans l'atelier et forcer l'industriel à accepter leurs conditions »106.
§43 L'idée que les coalitions ouvrières seraient des variantes ou des formes imparfaites d'associations de producteurs contredit non seulement le caractère des grèves mais les « systèmes de sentiments et d'idées qui s'y rattachent »107^.^ Les grèves sont des « actions de guerre »108, des « rudiments de guerre civile »109, ce que démontrent les actes de violence qui les accompagnent très souvent et « le fait de cette irradiation nous apprend qu'il y a une grande affinité entre les sentiments que provoquent les grandes grèves et les instincts de révolte latents dans les masses »110.
C'est au sujet de ces violences, écrit Sorel, que « le contraste se manifeste avec le plus de netteté ; les points de vue des patrons et des ouvriers sont complètement opposés »111, mais il existe une opposition beaucoup plus profonde qu'il faut mettre en lumière.
La thèse patronale est limpide :
« Pour les patrons, la loi de 1864 a donné simplement aux ouvriers la faculté de se concerter en vue de cesser leur travail et a fait disparaître le délit que l'ancien Code de 1810 voyait dans ce concert. Le droit de coalition se réduit donc au droit de rester chez soi ; il ne saurait faire obstacle au droit qu'ont d'autres ouvriers de travailler, si cela leur convient, et au droit qu'a le patron d'embaucher de nouveaux hommes, là où il en trouve. Le contrat de travail est rompu ; les deux parties contractantes sont libres : si les anciens ouvriers cherchent à empêcher la marche normale de l'atelier, ils se livrent à une manœuvre déloyale »112.
Quant à la thèse ouvrière, elle doit être élucidée dans toutes ses implications. La grève représente alors « un effort combiné des ouvriers pour forcer l'employeur à faire droit à leurs demandes en l'empêchant d'exercer son industrie jusqu'à ce qu'il se soit soumis »113. C'est pourquoi elle inclut notamment l'usage de pressions pour s'opposer au travail de non-grévistes : « si l'on n'empêche par des mesures coercitives l'employeur de se procurer des hommes qui remplacent ceux qui ont cessé de travailler, une grève n'est qu'une arme de paille »114.
§44 Le droit de grève et de coalition n'est donc pas aux yeux des ouvriers, selon Sorel, une liberté individuelle : « pour eux, la coalition n'est pas une liberté accordée à chacun d'eux pour former des concerts relatifs au refus du travail »115. Le droit de coalition doit être considéré, selon les catégories du droit romain, comme un droit réel, à savoir un droit qui porte directement sur une chose, qui donne à son titulaire un pouvoir complet sur cette chose et qui est un droit opposable à tous. Celui qui détient un pareil droit « peut légitimement [en ] user dans toute l'étendue possible »116. C'est pourquoi « il ne s'agit plus de dire que la liberté de refuser le travail qu'a l'ouvrier s'exerce en même temps que la liberté d'embaucher d'autres travailleurs que possède le patron ; cette liberté du patron ne tend à rien moins qu'à supprimer le droit de coalition, et par suite elle est suspendue ; elle est tenue en échec par le droit réel des ouvriers »117. La « liberté du travail » revendiquée par les patrons et au profit des non-grévistes n'est qu'un droit personnel, un droit qui ne s'exerce qu'à l'égard d'une personne déterminée et « c'est un fait évident que les hommes n'exercent leurs droits personnels que dans les limites que leur imposent les droits réels d'autrui »118. Selon la terminologie justinienne reprise par Georges Sorel dans un autre texte, « Grèves et droit du travail », publié vingt ans plus tard, le droit de coalition, y compris le droit de contrainte de la majorité sur la minorité qui en découle, constitue un jus in re, alors que la liberté de travail ou le droit patronal au profit doivent se définir comme un jus ad rem [opposition entre « droit dans la chose » exprimant un droit réel inconditionné et « droit en rapport à la chose » exprimant un droit relatif et conditionné ]119.
§45 Sorel introduit la catégorie de droit réel par analogie entre le travail et la propriété : « le travail, considéré du point de vue corporatif, est bien une sorte de propriété »120. C'est en fonction de cette analogie qu'on peut considérer le droit de coalition comme un droit réel : « les ouvriers croient avoir un droit corporatif sur le travail qui se fait dans l'usine »121. A leurs yeux, leur droit collectif sur le travail se perpétue à travers la grève, la « rupture du contrat de travail » ne porte que sur les clauses financières (le paiement du salaire) « sans toucher aux obligations antérieures et supérieures, obligations qui résultaient de leur participation continue à l'industrie »122. En vertu du même droit réel, les ouvriers considèrent que le patron ne saurait fermer son entreprise sans leur consentement.
Les grèves représentent dès lors une situation privilégiée qui jette une lumière nouvelle tant sur la genèse du droit social que sur les aspects juridiques du socialisme.
§46 En premier lieu, elles font apparaître une discordance dans la symétrie apparente des parties d'un contrat de travail : « les ouvriers ne se considèrent pas comme des marchands de force de travail, comme Marx le suppose, mais comme des tenanciers ayant un droit à rester attachés à leur travail qui est leur patrimoine »123, alors qu'en revanche, « le maître de fabrique est un marchand dont le bénéfice est la différence existante entre deux groupes de créances »124. C'est de cette discordance que surgit, pour Sorel, la prééminence du droit réel du travailleur sur le droit personnel du capitaliste.
§47 En deuxième lieu, les grèves et tout particulièrement la contrainte exercée par les grévistes sont comme une manière d'expérimenter une image vivante de la révolution : « lorsqu'une coalition est menée avec vigueur, on voit se réaliser assez exactement le schéma que Marx a donné ; la masse des travailleurs, disciplinée, unie et organisée par la pratique même de l'usine, supprime la propriété capitaliste localement, temporairement, mais d'une façon absolue »125.
§48 Georges Sorel poursuivait par cette affirmation interpellante : « le juriste est beaucoup plus apte que l'économiste, le philosophe ou l'historien à faire comprendre l'absolu que renferme la grève ». Pour y parvenir, le juriste doit préserver son intransigeance intellectuelle, se garder de ce « prétendu socialisme savant » qui s'efforce « de trouver un compromis entre le droit bourgeois et les revendications du prolétariat » et au contraire « employer les ressources que lui fournit le droit romain pour mettre en pleine lumière les caractères de la lutte de classe »126.
Et Sorel concluait cet ultime écrit de 1919 sur le droit du travail par un appel lyrique brûlant adressé aux professeurs des Facultés de droit :
« J'adjure les professeurs de droit de démontrer à leurs auditeurs, au moyen d'une théorie juridique des grèves, que les conflits industriels actuels mettent en présence deux classes irréconciliables. Construisez donc, messieurs les juristes, suivant les principes de votre science, ces doctrines que, nous autres pauvres socialistes, nous ne pourrions aborder qu'en timides apprentis ; que les amphithéâtres universitaires entendent des discours dépouillés de toute sophistique de paix sociale ; des élèves, qui n'ont pas eu encore le temps d'oublier les enthousiasmes classiques, acclameront en vous des héros cornéliens de l'honneur scientifique. Qu'avez-vous à craindre ? La haine de ces démagogues qui regardent la philosophie marxiste des classes comme un blasphème contre la France ; mais l'opinion de ces gaillards-là est vraiment bien peu de choses »127.
§49 Il y a exactement un siècle que Georges Sorel a écrit ces mots. Mise à part une forme de pathos incontestablement datée (les professeurs de droit revêtus d'une toge de héros cornéliens !), il faudrait se demander si l'actualité en Europe et dans le monde ne confère pas une vigueur renouvelée à cet appel. L'air du temps social est conflictuel, les humeurs des protagonistes se radicalisent, les voix consensuelles deviennent aphones. Il est plus que temps de rappeler que la guerre sociale est le père du droit social.
que temps de rappeler que la guerre sociale est le père du droit social**.**
Kojève A., Esquisse d'une phénoménologie du droit, Paris, Gallimard, 1982. ↩
Vogel-Polsky E. et Vogel J., L'Europe sociale 1993 : Illusion, alibi ou réalité ?, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1991.* * ↩
Vogel J., « Déclin du modèle social européen ? », in Telò M. avec la coll. de Gobin C., Quelle Union sociale européenne ?, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1994, pp. 195-209. ↩
Ibid., p. 197. ↩
Gurvitch G., L'idée du Droit Social, Paris, Recueil Sirey, 1932. ↩
Habermas J., Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé, Paris, Payot, 1978. ↩
Vogel J., « Déclin du modèle social européen ? », op. cit., p. 203*.* ↩
Ibid., p. 206. ↩
On trouvera une analyse éloquente de la déconstruction des droits sociaux européens in Supiot A. (dir.), Les gardiens des droits sociaux en Europe Semaine sociale Lamy, supplément, n° 1746, 28 novembre 2016. ↩
Sorel G., Matériaux d'une théorie du prolétariat, Paris, Marcel Rivière, 1919, pp. 2-5. ↩
Sorel G., « Idées socialistes et faits économiques au XIXe siècle », in La Revue socialiste, Vol. XXXV, 1902, pp. 294-318, pp. 385-410, pp. 519-544 et, p.403. ↩
Sorel G., « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? », in Revue de métaphysique et de morale, Tome VII, 1899, pp. 152-175, p. 165. ↩
Sorel G., **« **L'éthique du socialisme », in Revue de métaphysique et de morale, mai 1899, Tome VII, 1899, pp.280-301, p. 285-86. ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », in Le Devenir social, Vol. II, 1896, pp. 785-817, 906-941, 1013-1046. ↩
Vico J.-B., Principes de philosophie de l'histoire tirés de la Scienza Nuova, Bruxelles, Société belge de Librairie, 1839, p. 372. ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op. cit., p. 906. ↩
Vico J.-B., Oeuvres choisies, tome I, Bruxelles, Meline, Cans et cie, 1840, p. 126. ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op. cit., p. 801. ↩
Marx K., Le capital, in Œuvres, T. I, Economie, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1963, pp. 590-91. ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op. cit., p. 907. ↩
Ibid., p. 912-13. ↩
Ibid., p. 911. ↩
Sorel G., « Les aspects juridiques du socialisme », La Revue socialiste, vol. XXXII, 1900, pp. 385-415, pp. 558-585, pp. 389-90 et p. 393. ↩
Ibid., p. 390. ↩
Sorel G., Matériaux d'une théorie du prolétariat, op. cit., p. 66. ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op cit., p. 911. ↩
Ibid., pp. 930-31 ↩
Ibid., pp. 931-32. ↩
Ibid., p. 938. ↩
Ibid., pp. 914-15. ↩
Sorel G., **« **L'éthique du socialisme », op. cit., p. 291. ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op. cit., p. 797, note 1. ↩
Ibid., p. 932. ↩
Sorel G., « Was man von Vico lernt », Sozialistische Monatshefte, 1898, n° 2, p. 271. On peut consulter cet article sur le site de la Fondation Friedrich Ebert :
http://library.fes.de/cgi-bin/digisomo.pl?id=04354&dok=1898/1898_06&f=1898_0270&l=1898_0272 ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op.. cit., p. 1046. ↩
L'expression « lutte sur le droit » revient dans plusieurs autres textes de Sorel : « La crise du socialisme », Revue politique et parlementaire, XVIII, décembre 1898, pp. 597-612 ; **« **L'éthique du socialisme », op. cit., pp. 280-301 ; « Quelques objections au matérialisme économique », Humanité nouvelle, vol. IV, 1899, pp. 657-65 et vol. V, 1900, pp. 30-43. Sorel rejette l'expression de « lutte pour le droit » qu'il juge non-conforme au matérialisme historique (« Étude sur Vico », op. cit., p. 1046). ↩
Ibid., p. 939. ↩
Marx K., Misère de la philosophie, in Œuvres, T. I, Economie, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1963, pp. 135-36. ↩
Sorel G., « Quelques objections au matérialisme économique », op. cit., p. 34. ↩
Matériaux d'une théorie du prolétariat, op. cit., p. 100. ↩
Sorel G., L'avenir socialiste des syndicats, in Sorel G., Matériaux d'une théorie du prolétariat, op. cit., p. 83 n°.. ↩
Sorel G., « La crise du socialisme », op. cit., p. 602. ↩
Sorel G., « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme », in Revue internationale de sociologie, avril-mai1900, pp. 262-284, pp. 348-369 et précisément ,. 362. ↩
Marx K., Misère de la philosophie, op. cit., p. 135. ↩
« Quelques objections au matérialisme économique », op. cit., p. 34. J'ai modifié la rédaction de ce passage pour corriger ce qui était manifestement un contresens. Sorel ajoute en note que « l'émancipation économique des travailleurs » mentionnée dans les statuts rédigés par Marx en 1864 pour la Ière Internationale correspond au « changement des rapports juridiques que l'on poursuit comme but ». ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op. cit., p. 933. ↩
Sorel G., « Quelques objections au matérialisme économique », op. cit., p. 34. ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op. cit., p. 934. ↩
Ibid. ↩
Sorel G., « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme », op. cit., p. 352. ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op. cit., p. 935. ↩
Sorel G., « Étude sur Vico », op. cit., p. 935. ↩
IbSd.. ↩
Ibid. ↩
Sorel G., « Les dissensions de la social-démocratie allemande », Revue politique et parlementaire, vol. XXIII, 1900, pp. 33-66. ↩
Ibid., pp. 49-50. ↩
ISid., p.61. ↩
Ibid., p. 55, p. 63. ↩
Ibid., p. 65. ↩
Sorel G., **« **L'éthique du socialisme », op. cit., p. 290. ↩
Ibid., p. 291. ↩
Ibid., p. 290. ↩
Ibid., p. 290. ↩
Ibid, p. 288. ↩
Ibid., p. 288. ↩
Ibid., p. 289. ↩
Ibid., p. 290. ↩
Ibid., p. 290. ↩
Ibid., p. 289. ↩
Sorel G., « Les aspects juridiques du socialisme », op. cit., p. 386. ↩
Sorel G., **« **L'éthique du socialisme », op. cit., p. 280. ↩
Ibid., p. 281. ↩
Cf. Weber M., Sociologie du droit (trad. Par J. Grosclaude), Paris, PUF, 1986, pp. 209-212. ↩
Sorel G., « Idées socialistes et faits économiques au XIXe siècle », op. cit., p. 306. ↩
Sorel G., **« **L'éthique du socialisme », op. cit., p. 281. ↩
Sorel G., Ibid., op. cit., p. 281. Cette notion est plus étendue, tout en l'incluant, que celle de « droit ouvrier » au sens propre, que Sorel définit comme « les usages qui se forment dans le corps des travailleurs, qui peuvent, par perfectionnement, devenir le droit futur et qui provisoirement peuvent acquérir assez de prestige pour influencer la jurisprudence des tribunaux » (Matériaux d'une théorie du prolétariat, op. cit., p. 73, note 1). ↩
Ibid., op. cit., p. 283. ↩
Sorel G., « Le idee giuridiche nel marxismo », in Sorel G., aggi di Critica del Marxismo, Milan-Palerme-Naples, Sandron, 1903, pp. 189-223. ↩
Marx K., Le capital, op. cit., p. 716. ↩
Ibid., p. 1036. Il s'agit des quatre espèces de contrats distinguées par les jurisconsultes romains : (1) l'accord par lequel je conviens de vous donner telle chose et vous convenez de m'en donner une autre en échange ; (2) l'accord par lequel je conviens de vous donner telle chose et vous convenez que vous ferez quelque chose pour moi ; (3) l'accord par lequel je conviens de faire quelque chose pour vous et vous convenez de me donner telle chose ; (4) l'accord par lequel deux personnes conviennent de faire réciproquement quelque chose l'une pour l'autre. ↩
Ibid., p. 736. ↩
Ibid., pp. 745-46. ↩
Ibid., p. 1264. ↩
Ibid., p. 833. ↩
Ibid., p. 941. ↩
Ibid., p. 1273. ↩
Ibid., p. 837. ↩
Ibid., p. 834. ↩
Sorel G., « Le idee giuridiche nel marxismo », op. cit., p. 198. ↩
Marx K., Le Capital, op. cit., pp. 789-90. ↩
Ibid., p. 791. ↩
« Le idee giuridiche nel marxismo », op. cit., p. 206 ↩
Sorel G., **« **L'éthique du socialisme », op. cit., p. 287. ↩
Ibid. ↩
Marx K., Adresse inaugurale de l'Association internationale des travailleurs, iuvres, T. I, op. cit., p. 466 ↩
Sorel G., **« **L'éthique du socialisme », op. cit., p. 288. ↩
Sorel G., « Le idee giuridiche nel marxismo », op. cit., pp. 206-07. ↩
Sorel G., « Le prétendu ''socialisme juridique'' », in Le Mouvement socialiste, IIe série, VIII, 1907, pp. 321-348, pp. 324-25. ↩
Ibid., p. 343. ↩
Ibid., p. 342. ↩
Sorel G., « Grèves et droit au travail », in Sorel G., Matériaux d'une théorie du prolétariat, op. cit., p. 407. ↩
Rapport d'E. Ollivier au Corps législatif (Dalloz, 1864, IV, p. 61). ↩
Proudhon P.-J., De la capacité politique des classes ouvrières, Paris, Marcel Rivière, 1924, p. 390. ↩
Sorel G., « Les grèves », La Science sociale, octobre & novembre 1900, pp. 311-332, 417-436, p. 312. ↩
Ibid., p. 326. ↩
Ibid., p. 326. ↩
Ibid., p. 312. ↩
Ibid., p. 326. ↩
Ibid., p. 328. ↩
Ibid., p. 328. ↩
Ibid., p. 428. ↩
Ibid., p. 429. Pour Sorel, le fait que la loi de 1849 ait supprimé toute distinction entre ouvriers et patrons « n'était pas un progrès au point de vue juridique ; ce n'était qu'une manifestation de libéralisme stérile » (p. 432). ↩
Ibid., p. 433. ↩
Ces deux citations sont extraites de l'arrêt du juge américain Jenkins en 1895 et correspondent exactement, d'après Sorel, à l'idée que les ouvriers se font de la grève. ↩
Ibid., p. 433. ↩
Ibid., p. 434. ↩
Ibid., p. 434. ↩
Ibid., p. 434. ↩
Sorel G., « Grèves et droit au travail », in Sorel G., Matériaux d'une théorie du prolétariat, op. cit., p. 408. ↩
Sorel G., « Les grèves », op.. cit., p. 435 ↩
Ibid., p. 435. ↩
Ibid., p. 436. ↩
Ibid., p. 436. Il précise ailleurs : Le jus in re des grévistes sur l'usine où ils travaillent « les fait ressembler à des propriétaires de fonds ruraux ayant un intérêt collectif (« Grèves et droit au travail », in Sorel G., Matériaux d'une théorie du prolétariat, op. cit., p. 408). ↩
Sorel G., « Grèves et droit au travail », in Sorel G., Matériaux d'une théorie du prolétariat, op. cit., p. 409, note 1. ↩
Ibid., p. 411. ↩
Ibid., p. 411. ↩
Ibid., pp. 412-13. ↩